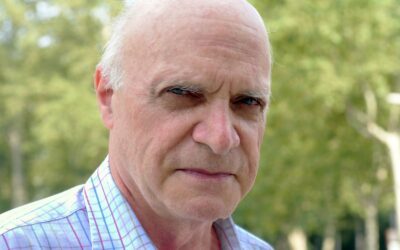Église et société : quelles vocations pour les laïcs ?
Les laïcs, membres de l’Église par leur baptême, qui participent à la mission de l’Église au cœur de la vie de la société, semblent être au centre de la stratégie du pape François pour réformer l’Église. Leur parole, s’ils s’en saisissent à l’occasion du Synode 2021-2023, peut transformer son visage pour les décennies à venir.
© SSVP – Meghann Marsotto
L’Église, notamment en France, est frappée par une crise sans précédent. Le rapport Sauvé, paru en octobre dernier, montre, entre autres, les conséquences néfastes du cléricalisme qui, selon les termes du pape François, est une conception « déviante » de l’autorité dans l’Église, « un danger à éliminer », « car le prêtre, (…) l’évêque est un serviteur de la communauté ». Les signaux d’une conversion de l’Église sont pourtant bien présents, depuis plusieurs décennies. Le terreau fertile dans lequel germent les graines d’un renouveau, c’est le fondement que pose le Concile Vatican II sur l’égalité baptismale. Cette affirmation d’une égale dignité de tous les baptisés remet en question la position de pouvoir – désirée ou subie – des clercs. Une réflexion s’engage à présent sur la forme à donner à ce renouveau, à travers le processus du Synode 2021-2023, ouvert en octobre 2021, sur le thème « Pour une Église synodale : communion, participation et mission ». « L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et de discernement que l’Église tout entière entend mener au cours des deux prochaines années, explique la Conférence des évêques de France, afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. C’est un événement important (…) qui concerne tous les chrétiens fidèles laïcs, clercs et personnes consacrées. » Cette opportunité doit permettre de repenser la participation de chacun à l’édification du Royaume de Dieu, notamment celle des laïcs et y compris, parmi eux, celle des femmes.
« Les exégètes et historiens montrent aujourd’hui que la nouveauté du Christ, qui ne traitait pas différemment les femmes et les hommes, n’a pas résisté aux traditions patriarcales qui prévalaient dans la plupart des sociétés », regrette la théologienne Monique Baujard dans son article « Église catholique. Où sont les femmes ? », publié en 2020 dans la Revue Projet.
Repenser la gouvernance
Revoir la place de chacun, c’est revoir la gouvernance, estime Sœur Véronique Margron, dominicaine, théologienne et présidente de la Conférence des religieux et religieuses en France (CORREF) : « Il faut repenser la place des prêtres et des évêques en la distinguant de la notion de pouvoir et distinguer le service de la communion de la question des responsabilités pour faire vivre une communauté paroissiale. » Cette question devrait même, selon elle, être traitée avant de décider si l’on ordonne des prêtres mariés ou des femmes prêtres, « parce que si on ne change rien aux modalités de gouvernance, on risque alors la survenue d’un nouveau cléricalisme avec des prêtres mariés, des femmes prêtres ou même des laïcs à qui l’on a confié des responsabilités ».
Revoir la gouvernance, cela suggère de repenser ce qu’on entend par la gouvernance. Dans l’article « Nouvelles paroisses – Nouvelles positions des prêtres », Mgr Albert Rouet, archevêque émérite de Poitiers et artisan des « communautés locales », disait déjà, en 2012 :
« Gouverner – une des tâches confiées par l’ordination et la nomination – ne consiste pas d’abord à commander. Un chef militaire et un capitaine d’industrie ne commandent que s’ils ont une stratégie. Faut-il garder ces références au lieu de suivre les injonctions du Christ sur le pouvoir ? Gouverner demande alors de relier, d’orienter, de conforter, donc autre chose que tout ordonner et régir. […] Le prêtre, poursuit-il, coordonne les initiatives, stimule les ardeurs, conforte et nourrit la foi : en cela, il enfante des croyants adultes. » recueillement dans une chapelle d’Angers avant les tournées de maraudes pour l’équipe étudiante Saint-Serge. « Il ne faut pas non plus que la prière nous exempte de l’action, avertit Pauline Six, 29 ans, présidente de l’équipe susnommée Pier-Giorgio-Frassati. Lors de la crise sanitaire, nous bouillions de rester les bras croisés ! »
D’où la session d’été d’une semaine proposée depuis deux ans aux jeunes Vincentiens : à en juger par son succès (40 inscrits en 2020, 60 en 2021), la soif de s’ancrer en Dieu est vive chez la génération montante ! « Je ne me demande pas en quoi croient les personnes à la rencontre desquelles je vais, confie Pierre-Louis voir la rubrique « Témoignages ». Mais, j’ai besoin d’être porté spirituellement par la SSVP. Voir des chrétiens aussi fervents lors de la session d’été m’a rempli d’Espérance ! » Cette soif se double du désir de rester ouverts aux bénévoles athées ou d’autres confessions, comme cela se vit depuis toujours au sein des équipes de la SSVP – celle de Châteaubriant (voir la rubrique « Et à la SSVP ? ») compte, par exemple, plusieurs agnostiques.
Repenser la gouvernance
Revoir la place de chacun, c’est revoir la gouvernance, estime Sœur Véronique Margron, dominicaine, théologienne et présidente de la Conférence des religieux et religieuses en France (CORREF) : « Il faut repenser la place des prêtres et des évêques en la distinguant de la notion de pouvoir et distinguer le service de la communion de la question des responsabilités pour faire vivre une communauté paroissiale. » Cette question devrait même, selon elle, être traitée avant de décider si l’on ordonne des prêtres mariés ou des femmes prêtres, « parce que si on ne change rien aux modalités de gouvernance, on risque alors la survenue d’un nouveau cléricalisme avec des prêtres mariés, des femmes prêtres ou même des laïcs à qui l’on a confié des responsabilités ». Revoir la gouvernance, cela suggère de repenser ce qu’on entend par la gouvernance. Dans l’article « Nouvelles paroisses – Nouvelles positions des prêtres », Mgr Albert Rouet, archevêque émérite de Poitiers et artisan des « communautés locales », disait déjà, en 2012 : « Gouverner – une des tâches confiées par l’ordination et la nomination – ne consiste pas d’abord à commander. Un chef militaire et un capitaine d’industrie ne commandent que s’ils ont une stratégie. Faut-il garder ces références au lieu de suivre les injonctions du Christ sur le pouvoir ? Gouverner demande alors de relier, d’orienter, de conforter, donc autre chose que tout ordonner et régir. […] Le prêtre, poursuit-il, coordonne les initiatives, stimule les ardeurs, conforte et nourrit la foi : en cela, il enfante des croyants adultes. » recueillement dans une chapelle d’Angers avant les tournées de maraudes pour l’équipe étudiante Saint-Serge. « Il ne faut pas non plus que la prière nous exempte de l’action, avertit Pauline Six, 29 ans, présidente de l’équipe susnommée Pier-Giorgio-Frassati. Lors de la crise sanitaire, nous bouillions de rester les bras croisés ! » D’où la session d’été d’une semaine proposée depuis deux ans aux jeunes Vincentiens : à en juger par son succès (40 inscrits en 2020, 60 en 2021), la soif de s’ancrer en Dieu est vive chez la génération montante ! « Je ne me demande pas en quoi croient les personnes à la rencontre desquelles je vais, confie Pierre-Louis voir la rubrique « Témoignages ». Mais, j’ai besoin d’être porté spirituellement par la SSVP. Voir des chrétiens aussi fervents lors de la session d’été m’a rempli d’Espérance ! » Cette soif se double du désir de rester ouverts aux bénévoles athées ou d’autres confessions, comme cela se vit depuis toujours au sein des équipes de la SSVP – celle de Châteaubriant (voir la rubrique « Et à la SSVP ? ») compte, par exemple, plusieurs agnostiques.
Chiffres clés
1,345 milliard C’est le nombre de baptisés dans le monde, soit 17,7% de l’humanité appelés à s’exprimer lors du grand synode sur la synodalité. (Source : Annuaire pontifical 2021) Le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire.
Le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire.

Les laïcs témoignent de leur foi en Dieu par leurs actions dans la société de multiples manières. Ici, des bénévoles du Secours Catholique de Tourcoing offrent des cours de français à des personnes nouvellement arrivées en France.
© SSVP – Meghann Marsotto
Des « croyants adultes »
Cette idée de « croyants adultes » souligne l’importance d’une capacitation des laïcs. C’est, déjà aux XVIIe et XIXe siècles, l’inspiration et la conviction traduites en actes par saint Vincent de Paul et Frédéric Ozanam dans les œuvres de charité portées par des laïcs – y compris des femmes – et plus seulement par les clercs et les congrégations religieuses, comme c’était essentiellement le cas à l’époque. Aujourd’hui, la capacitation des laïcs s’exprime, en France, par des initiatives telles que Promesses d’Église. Ce collectif d’organisations catholiques (dont la Société de Saint-Vincent-de-Paul fait partie), est né de l’impact qu’a eu, en 2018, la Lettre au peuple de Dieu du pape François, dans laquelle il estime « impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu ». La mise en commun de bonnes pratiques de gouvernance par les membres du collectif, tirées de leur expérience de terrain, peut guider l’Église dans son chemin synodal. L’encouragement à la capacitation fait d’ailleurs partie de l’ADN de la Société Saint-Vincent-de-Paul dont la Règle internationale affirme notamment,
dans l’article 1.10, que « les Vincentiens essaient d’aider les pauvres à être indépendants, dans la mesure du possible, et à se rendre compte que, de façon pratique, ils peuvent forger et changer leur destinée de même que celle de leur entourage ». Une source d’inspiration pour l’Église, si elle réfléchit à la façon de mener ses brebis non pas de manière paternaliste, mais en favorisant leur autonomie.
Une Église de l’écoute et du service
Et quand les laïcs se prennent en charge, sensibles qu’ils sont aux « signes des temps », comme les appelait Jean XXIII, ils offrent, en réponse aux besoins du monde, des initiatives originales qui constituent autant de possibles rencontres avec le Christ. Le fleurissement d’un grand nombre de tiers-lieux chrétiens, dont Le Pèlerin a rendu compte dans une enquête en juillet dernier, en témoigne. « Réaménager en vue de la mission, c’est diversifier les lieux de présence de l’Église et ne plus compter exclusivement sur la paroisse », avait pressenti le théologien Gilles Routhier en 2001.
Dans des coworkings, des cafés associatifs…, les laïcs, comme l’avait souligné le pape Jean Paul II en 1988, « occupent une place originale et irremplaçable : par eux, l’Église du Christ est présente dans les secteurs les plus variés du monde, comme signe et source d’espérance et d’amour ». Outre le gain de confiance en eux-mêmes que doivent conquérir les laïcs, leur prise de responsabilités devra s’accompagner d’une formation adéquate… et du soutien bienveillant des clercs. « Le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire », énonçait en 2015 le pape François. Charge maintenant aux responsables de l’Église de faire preuve de confiance. Comme le souligne le théologien Alphonse Borras, « c’est à ce prix seulement, d’ailleurs, que l’Évangile porte des fruits ».
 ALLER PLUS LOIN
ALLER PLUS LOIN
• Pour mieux comprendre ce que le pape François entend par « le cléricalisme » : article La Croix « Dix pistes pour sortir du cléricalisme », 29 août 2018.Des « croyants adultes »
Cette idée de « croyants adultes » souligne l’importance d’une capacitation des laïcs. C’est, déjà aux XVIIe et XIXe siècles, l’inspiration et la conviction traduites en actes par saint Vincent de Paul et Frédéric Ozanam dans les œuvres de charité portées par des laïcs – y compris des femmes – et plus seulement par les clercs et les congrégations religieuses, comme c’était essentiellement le cas à l’époque.
Aujourd’hui, la capacitation des laïcs s’exprime, en France, par des initiatives telles que Promesses d’Église. Ce collectif d’organisations catholiques (dont la Société de Saint-Vincent-de-Paul fait partie), est né de l’impact qu’a eu, en 2018, la Lettre au peuple de Dieu du pape François, dans laquelle il estime « impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu ». La mise en commun de bonnes pratiques de gouvernance par les membres du collectif, tirées de leur expérience de terrain, peut guider l’Église dans son chemin synodal. L’encouragement à la capacitation fait d’ailleurs partie de l’ADN de la Société Saint-Vincent-de-Paul dont la Règle internationale affirme notamment, dans l’article 1.10, que « les Vincentiens essaient d’aider les pauvres à être indépendants, dans la mesure du possible, et à se rendre compte que, de façon pratique, ils peuvent forger et changer leur destinée de même que celle de leur entourage ». Une source d’inspiration pour l’Église, si elle réfléchit à la façon de mener ses brebis non pas de manière paternaliste, mais en favorisant leur autonomie.
Une Église de l’écoute et du service
Et quand les laïcs se prennent en charge, sensibles qu’ils sont aux « signes des temps », comme les appelait Jean XXIII, ils offrent, en réponse aux besoins du monde, des initiatives originales qui constituent autant de possibles rencontres avec le Christ. Le fleurissement d’un grand nombre de tiers-lieux chrétiens, dont Le Pèlerin a rendu compte dans une enquête en juillet dernier, en témoigne. « Réaménager en vue de la mission, c’est diversifier les lieux de présence de l’Église et ne plus compter exclusivement sur la paroisse », avait pressenti le théologien Gilles Routhier en 2001. Dans des coworkings, des cafés associatifs…, les laïcs, comme l’avait souligné le pape Jean Paul II en 1988, « occupent une place originale et irremplaçable : par eux, l’Église du Christ est présente dans les secteurs les plus variés du monde, comme signe et source d’espérance et d’amour ».
Outre le gain de confiance en eux-mêmes que doivent conquérir les laïcs, leur prise de responsabilités devra s’accompagner d’une formation adéquate… et du soutien bienveillant des clercs. « Le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire », énonçait en 2015 le pape François. Charge maintenant aux responsables de l’Église de faire preuve de confiance. Comme le souligne le théologien Alphonse Borras, « c’est à ce prix seulement, d’ailleurs, que l’Évangile porte des fruits ».
 ALLER PLUS LOIN
ALLER PLUS LOIN
• Pour mieux comprendre ce que le pape François entend par « le cléricalisme » : article La Croix « Dix pistes pour sortir du cléricalisme », 29 août 2018.
« Dieu nous appelle à servir ensemble »
Sœur Françoise Petit, supérieure générale de la Compagnie des Filles de la Charité, fondée par saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac, nous éclaire sur la manière avec laquelle ils ont œuvré aux côtés de fidèles laïcs pour l’Église et la société.En quoi saint Vincent de Paul, à son époque, a-t-il été novateur ?
Lorsque saint Vincent et sainte Louise ont découvert la misère matérielle et spirituelle de leur époque, ils ont commencé, et n’ont jamais cessé, à collaborer avec d’autres, des femmes en particulier qui, les premières, se sont associées pour se mettre au service des personnes pauvres de leur époque. Saint Vincent n’a jamais œuvré seul. Il tenait compte des suggestions et des intuitions de sainte Louise. Il faisait appel avec audace, confiance et discernement aux différents acteurs de l’Église et de la société en vue de lutter sans cesse contre la misère et les injustices. Il avait saisi que l’Esprit soufflait sur toute personne de bonne volonté, homme ou femme, ce qui était, pour l’époque, tout à fait nouveau.Le service aux fragiles, aux isolés, aux pauvres et aux marginaux, est-ce un devoir pour les laïcs ?
Se mettre au service des plus fragiles est un devoir mais, c’est surtout un appel que reçoit tout baptisé et tout homme et femme de bonne volonté au nom de notre
humanité commune. Cette conviction nous fait devenir les prochains de nos frères et sœurs les plus démunis et nous entraîne ainsi à mettre générosité, capacités et temps au service des autres, avec d’autres.
Que reste-t-il aujourd’hui
de la spiritualité vincentienne ?
Il est évident que la spiritualité vincentienne a marqué l’histoire de l’Église et de la société, notamment par rapport aux structures sociales mais surtout, saint Vincent et sainte Louise ont eu le génie de mettre en commun les richesses des uns et des autres pour répondre aux appels de détresse. Ils ont su aussi mettre en route des hommes et des femmes, chacun selon sa propre vocation, au sein de Congrégations, comme la Compagnie des Filles de la Charité, ou dans des associations si nombreuses dans le monde, en particulier la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Progressivement, la conscience de l’engagement et de la responsabilité partagée est devenue une réalité. L’actuel chemin synodal de l’Église illustre très bien ce mouvement et assurément, saint Vincent nous inviterait à y entrer avec enthousiasme, avec la certitude que Dieu nous appelle à servir ensemble et qu’il est toujours possible de faire davantage.

Crédit photo : © DR
SUITE DU DOSSIER "Église et société : quelles vocations pour les laïcs ?"
Évangéliser en toute simplicité
« La sécularisation* nous fournit le cadre pour vivre ensemble dans la diversité de nos convictions. Elle met en avant la pluralité des convictions et le respect de l’autre, ce qui n’était pas le cas dans les sociétés anciennes, des sociétés marquées par une seule culture religieuse.
Interview du père François Glory
Le père François Glory, prêtre des Missions étrangères de Paris (MEP), a passé 35 ans au Brésil. Il en tire une expérience communautaire inspirante, qui influence son regard sur une Église en crise, vouée à choisir entre inertie destructrice ou réformes en profondeur.