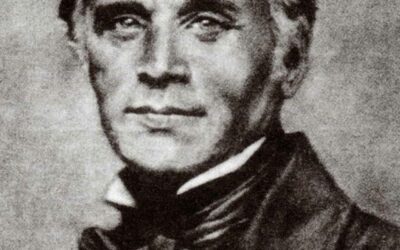La visite à domicile, fondement de la première Conférence
Venir au cœur de l’intimité des personnes en précarité est une action fondatrice de la SSVP. Retour sur l’histoire des débuts de cette pratique initiée par Frédéric Ozanam lui-même.
L’idée en revenait à Frédéric Ozanam. Lorsque les jeunes confrères avaient voulu faire une œuvre de charité, M. Bailly les avait envoyés voir le Père Olivier, curé de Saint-Étienne-du-Mont. Celui-ci leur avait proposé de faire le catéchisme aux enfants pauvres, proposition qu’ils avaient déclinée. En effet, après les critiques qu’ils avaient essuyées de la part de leurs camarades athées, il leur paraissait préférable de privilégier « le pain du corps par rapport au pain de l’âme ».
Une inspiration familiale ?
Aucun n’avait une connaissance personnelle du contact avec les pauvres. D’où était donc venue cette idée ? La visite à domicile se pratiquait dans d’autres œuvres. Pour Ozanam, son père la pratiquait, quand il allait soigner gratuitement les pauvres – c’est d’ailleurs chez une famille pauvre qu’il fera une chute mortelle –, et sa mère faisait partie de « l’œuvre des veilleuses », dont elle était responsable pour sa paroisse. Cette œuvre était composée d’ouvrières pauvres, qui allaient passer la nuit auprès de femmes malades, qui n’avaient pas les moyens d’aller à l’hôpital. C’est peut-être ce qui l’avait inspiré.
Si le principe était accepté par tous, « encore fallait-il s’entendre sur les modalités concrètes : quels seraient les pauvres à visiter, quels secours leur apporter, et avec quelles ressources ? »
M. Bailly, qui présidait la séance, d’accord avec ce choix, les adressa à Sœur Rosalie, qu’il connaissait. Devaux devait la contacter.
SŒUR Rosalie en précurseur
La Sœur œuvrait dans le quartier Mouffetard, c’est-à-dire non loin de la Sorbonne où habitaient quatre confrères sur six, dont Ozanam.
Un ancien administrateur du bureau de charité de l’arrondissement pria la Sœur « de mettre la Conférence en rapport avec celles [des familles] qu’elle supposait mieux disposées à accueillir les visites de nos novices en cette pratique de la charité ». La semaine suivante, chacun avait une famille pauvre à visiter, choisie par lui et pour lui.
Ces jeunes allaient trouver des situations qu’ils n’imaginaient pas : « Des deux côtés d’un ruisseau infect, s’élèvent des maisons de cinq étages, dont plusieurs réunissent jusqu’à cinquante familles… Au fond d’une sorte de cave, habitait une famille sans autre couche qu’un peu de paille, sur le sol décarrelé… Dans la chambre voisine, une femme avait perdu trois enfants morts de phtisie (tuberculose pulmonaire) et en montrait avec désespoir trois autres réservés à la même fin. »
La famille qui échut à Ozanam offrait le spécimen d’une misère morale pire encore que d’autres. « Le ménage se composait d’une mère qui s’épuisait de travail pour faire vivre cinq enfants, et d’un mari ivrogne qui lui prenait ce qu’elle gagnait pour boire… Elle était arrivée au dernier degré de la détresse et du désespoir, quand Ozanam la découvrit. Il ne tarda pas à reconnaître que le mariage n’existait pas… Ozanam le fit constater judiciairement, libéra la femme, et, moyennant une quête, lui procura le moyen de retourner dans sa Bretagne, avec ses deux plus jeunes enfants, en plaçant les deux aînés dans les ateliers de M. Bailly. C’était bien la double assistance matérielle et morale qu’avait recommandée le charitable président. »
 La visite à domicile demeurera l’action essentielle des jeunes confrères et celle qui leur permettra une déférence envers les pauvres, conforme à leur foi
La visite à domicile demeurera l’action essentielle des jeunes confrères et celle qui leur permettra une déférence envers les pauvres, conforme à leur foi
La Conférence en soutien
Une autre question était celle des ressources. « Il fut décidé que la Conférence ferait la charité à ses frais et que chacun contribuerait dans la mesure de ses forces, mesure dont il était seul juge… Une quête à la fin de chaque séance devait remplir ce but. Elle fut faite à la fin de la première séance par M. Devaux, désigné comme trésorier. » Les fonds provenaient aussi, pour partie, de la « Tribune Catholique », journal de M. Bailly, auquel collaboraient les jeunes confrères, dont Ozanam, moyennant rémunération.
Quant au secours à apporter, il fut décidé de ne pas le faire en argent mais en nature, au moyen de bons fournis, au départ, par la SœurRosalie, bons de viande, de pain et de bois.
Ainsi, si d’autres actions viendront plus tard, la visite à domicile demeurera l’action essentielle des jeunes confrères et celle qui leur permettra une déférence envers les pauvres, conforme à leur foi. C’est ce qu’écrira Ozanam : « Quand vous redoutez si fort d’obliger celui qui reçoit l’aumône, je crains que vous n’ayez jamais éprouvé qu’elle oblige aussi celui qui la donne. Ceux qui savent le chemin de la maison du pauvre, ceux qui ont balayé la poussière de son escalier, ceux-là ne frappent jamais à sa porte sans un sentiment de respect. » Mélanges 1848
Jean-Léon Le Prévost, bien que n’étant pas tout à fait du même milieu et ayant un emploi modeste, a, sans nul doute, un ascendant sur les jeunes confrères, de par son âge – il a dix ans de plus, ce qui le place entre eux et Emmanuel Bailly –, et son engagement.
1835 : l’organisation
Le nombre des membres devient important. Non sans mal, la première Conférence doit se dédoubler : Le Prévost devient président de la deuxième Conférence. Des membres, éloignés de la Montagne Sainte-Geneviève, obtiennent de se réunir près de chez eux. Des Conférences se créent en province.
La nécessité d’un règlement se fait jour, dont la rédaction est confiée à François Lallier. Le 8 décembre 1835, lors d’une réunion plénière, M. Bailly donne lecture des considérations préalables au règlement « presque textuellement tirées des écrits de saint Vincent de Paul ».
« À la suite de cette lecture, M. Bailly, prenant désormais le titre de Président de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, désigna pour vice-président Le Prévost, pour secrétaire général Brac de la Perrière, et pour trésorier Devaux. Ces quatre membres devaient former le Conseil de direction de la Société. »
En décembre 1840, en dépit des réserves d’Ozanam, qui le juge trop « clérical », lors de la création du Conseil Général, Le Prévost conserve sa charge de vice-président. Soutenu par M. Bailly, il avait pour lui d’être plus âgé et très dévoué.
Les Frères de Saint-Vincent-de-Paul
Ce qui oppose Le Prévost et Ozanam, c’est la question du « patronage », issu de l’Œuvre des orphelins apprentis dont le premier avait pris la direction. Pour passer d’un patronage, simple placement de l’apprenti, à un « patronage par réunion », soutien permanent, il fallait du temps et les étudiants en manquaient. C’est l’origine, le comme professeur en Alsace et à Lisieux. C’est là qu’il rencontre des prêtres qui lui font retrouver la foi et le désir de servir Dieu.
Donner du sens à sa foi
En 1825, il est engagé, à Paris, comme secrétaire de Mgr Frayssinous, premier aumônier du Roi. Il devient, par la suite, fonctionnaire au ministère des cultes où il reste vingt ans. C’est à partir de là, lors de sa rencontre avec Victor Pavie, jeune étudiant, que sa foi s’affermit et qu’il croise la route des jeunes catholiques qui sont à l’origine de la première Conférence de charité. Jean-Léon Le Prévost est comme tous ces jeunes, touché par la misère et, comme eux, il veut donner sens à sa foi.
En 1833, lors d’une rencontre avec Ozanam et ses compagnons dans un petit restaurant parisien, il est invité à faire partie de la Conférence de charité qu’ils viennent de créer. Il s’y montre très vite très actif dans l’instruction religieuse donnée aux jeunes détenus et, en général, auprès des pauvres.
Le patronage de Saint Vincent de Paul
Dès le départ, les membres de la Conférence de charité vouent un culte à saint Vincent de Paul, dont les reliques ont été transférées le 25 avril 1830 depuis Notre-Dame jusqu’à la chapelle des Lazaristes, 95 rue de Sèvres. Sa fête, le 19 juillet, est célébrée par les confrères en 1833.
Mais c’est lors de la séance du 4 février 1834 que « M. Le Prévost, se faisant l’interprète de plusieurs membres, demanda que la conférence se mette sous le patronage de saint Vincent de Paul et célèbre sa fête ».
3 mars 1845, de la création des frères de Saint-Vincent-de-Paul.
En 1844, Le Prévost rencontre Clément Myonnet, un jeune commerçant, qui a fondé la Conférence d’Angers et qui, face aux problèmes sociaux, souhaite aller plus loin en créant une congrégation sur le modèle des Filles de la Charité. Celle-ci voit le jour dans la chapelle où se trouvent les reliques de saint Vincent de Paul. Y participe un troisième membre, ami de Le Prévost, jeune vincentien, Maurice Maignen. Le seul frère, Myonnet, prend la tête du patronage.
Ordonné prêtre en 1860
À cette époque, M. Le Prévost est encore marié. Il a épousé en 1834 une femme nerveusement malade, de 17 ans son aînée. Il finit par obtenir d’elle une séparation de corps, quitte son emploi et devient supérieur de la congrégation, qui verra le jour le 3 octobre 1846. Maignen le rejoint.
Jean-Léon Le Prévost est ordonné prêtre le 22 décembre 1860, après le décès de son épouse.
Il décède à Chaville le 30 octobre 1874 et est déclaré vénérable le 21 décembre 1998.
EN SAVOIR +
« Oh ! combien de fois moi-même accablé de quelque peine intérieure, inquiet de ma santé mal raffermie, je suis entré plein de tristesse dans la demeure du pauvre confié à mes soins, et là, à la vue de tant d’infortunés plus à plaindre que moi, je me suis reproché mon découragement, je me suis senti plus fort contre la douleur, et j’ai rendu grâce à ce malheureux qui m’avait consolé et fortifié par l’aspect de ses propres misères ! Et comment, dès lors, ne l’aurais-je pas d’autant plus aimé ? »
F. Ozanam – aux confrères de Florence 1853